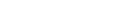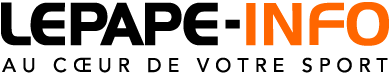Le nombre d’étapes à la Giro Rosa (10 en 2015) vs. le Tour de France (21 en 2015) est inégal. La distance des épreuves de cross country en vélo ou ski varient de 2 à 20 km entre les femmes et les hommes. Ces écarts de genre ne sont pas isolés et dénotent dans des activités comme la piste, le triathlon ou, pire, les Jeux Olympiques (distance de l’épreuve en cyclisme qui va du simple au double).
Imaginez que jusqu’en 1972 les femmes ne couraient pas le marathon de Boston, et qu’il a fallu attendre une convergence de facteurs pour valider le fait qu’ « il n’existe pas de preuves scientifiques ou médicales que les courses de longue-distance soit contre-indiquées pour les femmes en bonne santé » (traité de l’ACSM (American College of Sports Medicine en 1980).
C’est comme ça et pas autrement ?
Joan Benoit a largement contribué à faire vaciller les certitudes relatives à l’incapacité des femmes à réaliser les mêmes épreuves que leurs homologues masculines. Elle fut la première femme à gagner le marathon aux JO en 2:24:52. C’est donc avec un temps 50% plus rapide que beaucoup d’autres coureurs avant elle que Joan a complété l’épreuve…
Avec les années, l’écart de performance entre les sexes s’est peu à peu réduit. Dans les années 70 le record au marathon chez les femmes s’élevait à 3:02:53 contre 2:09:28 (source IAAF) pour les hommes ; en 2015, ces records s’abaissaient à 2:15:25 contre 2:02:57. En dépit de cette réduction, les inégalités persistent dans les standards de réglementation, et ce principalement en raison de lacunes persistantes dans la connaissance de la physiologie de l’athlète féminine d’endurance… Pourtant, ces écarts ne semblent pas justifiés.
La preuve par 3
- La consommation maximale d’oxygène (ou VO2max) est historiquement assumée comme « le » facteur de performance dans les épreuves d’endurance. Celle-ci est calculée comme le produit du débit cardiaque et de la capacité du muscle à extraire/utiliser l’oxygène du sang. Le débit cardiaque dépend de la densité des vaisseaux dans les poumons (capillaires) et de la capacité de transport du sang en O2. Où se situent donc les écarts homme/femme ? En moyenne, on peut mesurer 16 vs 14g d’hémoglobine /100ml sang chez les hommes vs. femmes, générant donc une différence de transport d’O2 et, consécutivement, de source d’énergie. De plus, le volume du cœur demeure inférieur chez les femmes, ce qui implique aussi une quantité de sang éjecté inférieure. Malgré cela, on peut observer chez des femmes entraînées des valeurs de VO2max qui dépassent les 60ml.kg.min-1 (eg. cyclistes) voire 70ml.kg.min-1 (eg. skieuses de demi-fond). Mieux encore, elles compensent leurs particularités en maintenant un plus haut pourcentage de VO2max lors de la course. Des valeurs objectives donc certes inférieures à l’homme, mais des valeurs bien supérieures à un individu moyen, et même à certains compétiteurs !
- On enchaine avec la ‘force/puissance’. Et oui, n’oubliez pas que c’est un facteur clé dans la performance en endurance de par l’amélioration de la résistance du muscle à la fatigue. Évidemment, les femmes sont (en moyenne) moins fortes que les hommes (de 40-60% sur les muscles du haut du corps, 25-30% pour le bas du corps) surtout en raison de la quantité de masse musculaire. Mais la puissance brute n’est pas pertinente en activité d’endurance ; c’est plutôt le rapport poids/puissance qui l’est, c’est-à-dire la puissance rapportée relativement à chaque kg. Et dans ce cas, les différences absolues s’éclipsent ! Hommes et femmes démontrent le même pourcentage de puissance maximale à l’atteinte de leur seuil lactique (~77%) ; aussi, lors d’événements sportifs identiques, coureurs et coureuses passent autant de temps à des puissances supérieures à ce seuil lactique qu’à des puissances inférieures (même répartition des puissances).
- Troisième point : l’utilisation des ressources. Là, on touche un point crucial pour une raison simple : si on suit ce rationnel, les normes devraient être inversées. En effet, les femmes semblent plus disposées à la pratique d’endurance que les hommes sur le versant métabolique de l’activité d’endurance. Elles brulent une plus grande proportion de graisses (vs. sucres) que les hommes, ce qui a l’avantage de représenter une économie métabolique pour les activités de longue durée. La raison ? Une régulation hormonale qui promeut l’oxydation des graisses plutôt que du glycogène. Ici, ce serait donc davantage les hommes qui auraient à faire des progrès…
D’après ces facteurs, une réévaluation des standards de compétitions d’endurance apparaît nécessaire. Et, quand bien même ceux-là ne suffiraient pas, quelques cas concrets sont là pour démontrer cette nécessité ?
La preuve par 3… +2 !
Connaissez-vous les épreuves d’ultra-endurance ? Ces fameuses courses où les standards de durée/distance dépassent les normes habituelles (ex : le marathon). Parmi ces épreuves, la course Badwater135 est considérée comme la course-à-pied la plus difficile au monde. Pourquoi ? 217km de course ! Des températures supérieures à 38°C ! Des côtes/pentes techniques et abruptes, etc. En 2002 et 2003, c’est l’athlète féminine Pamela Reed qui remporta cette course. Et ce n’est pas tout… Elle gagne la course mais… pas dans sa catégorie. Non, elle gagne parmi l’ensemble des participants, hommes et femmes confondus. Ce n’est pas fini ! Elle a devancé les 58 participants qui la poursuivaient (dont 42 hommes) de… 4 heures !! Cerise sur le gâteau, elle a remis le couvert l’année suivante devant 45 concurrents (dont 21 hommes), mais cette fois avec une avance (« que ») de 25 min.
Autre exemple ? L’ironman d’Hawaï, édition 2014 ! La tenante du titre Mirinda Carfrae a démontré non seulement qu’elle pouvait parfaitement compléter cette épreuve (3,8km de natation, 180,2km à vélo, et 1 marathon) (comme plusieurs femmes avant elle), mais qu’elle était surtout capable de battre (humilier ?) 20% des athlètes hommes professionnels et, anecdotiquement, 1377 des 1380 finishers hommes amateurs. Rien que ça…
Alors ? Encore suspicieux sur la capacité des femmes à réaliser les mêmes épreuves que nous ? Si ces athlètes restent certes exceptionnelles, elles sont le témoin d’une empreinte plus large. L’empreinte d’un changement nécessaire dans la réglementation des épreuves d’endurance pour les femmes qui ne doit plus constituer un mythe, mais une réalité.
Pour aller plus loin : Carmichael & Greenberg, Strength and conditioning journal. 2016.
Cyril Schmit