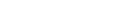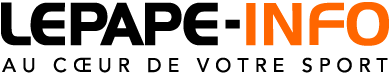Pédaler en philosophant. Voilà à quoi s’attèle, peu ou prou, Guillaume Martin. Le Normand, 26 ans, est féru de Nietzche. Il a consacré un mémoire au penseur allemand, intitulé : « le sport moderne : une mise en application de la philosophie nietzschéenne ? ». Son ambition : « repenser le sport moderne de manière plus authentique que ses fondateurs historiques ne l’ont pensé ».
Le 12e du Tour de France l’été dernier a réuni ses passions, dans Socrate à vélo (Grasset), fable-essai où Nietzche, Spinoza, Descartes, Aristote et consorts s’époumonent en pensées et pédalées durant un Tour de France fictif. L’écriture, la philosophie, le vélo, des univers avec lesquels Guillaume Martin joue, dit-il. « C’est déjà beaucoup » précise celui qui interprète ses partitions avec sérieux, que ce soit à stylo en main, à l’entraînement ou en course. « L’acteur doit croire à son personnage ! »
Dans Socrate à vélo, les néophytes de la chose cycliste ont l’occasion de découvrir la sphère des deux roues, ce « morne quotidien » où le sportif « travaille littéralement à s’incorporer certains mouvements » des heures durant, le cul planté sur sa selle. Les athlètes profanes en manière intellectuelle, s’essaieront, eux, avec jouissance à l’art de la dialectique, dans la roue de Marx, leader de l’équipe allemande qui s’insurge « du système inique des concentrations des richesses » des plus grandes équipes cyclistes, quand son coéquipier Altich lui rappelle que le sport est par définition inégalitaire.
A la lecture des pages se déplie ce « corps philosophe », modèle antique au sein duquel le sport et la philosophie étaient unis au sein de la cité. Penser et agir étaient tout sauf opposé, bien au contraire.
Entretien.
Quels sont les œuvres qui vous ont marqué ?
Il y a d’abord eu Propos sur le bonheur du philosophe Alain -qui est Normand comme moi- après une dictée. Puis en seconde, Ecce Homo de Nietzsche, à qui je suis très attaché. Ces deux livres ont pour point commun d’être des livres de philo pratiques, pas austères. Ce sont presque des discussions sur la manière de mieux vivre au quotidien. Alain donnait des conseils sur la façon de contenir son éructation ; Nietzsche, sur la diététique ou sur le meilleur climat, qui est le méditerranéen. C’est à l’opposé de l’image un peu négative que l’on peut avoir de la philosophie. Je m’y retrouve assez bien.
Et en ce qui concerne la littérature?
Cela a évolué au fil du temps. J’ai bien aimé l’œuvre Haruki Murakami, avec cette idée que l’irréel et le magique pouvaient s’immiscer au milieu de questions tout à fait pratiques et quotidienne.
J’ai eu ma période avec les auteurs russes. Tel que Dostoïevski, qui est évidemment un auteur qui parle aux jeunes adultes avec cette mise en valeur des passions humaines et ce côté enflammé que l’on retrouve chez Scott Fitzgerald, que j’aime bien également.
Des citations de ces auteurs-là vous accompagnent-elles dans votre carrière ?
Je suis un peu contradictoire mais je ne suis pas convaincu que la philosophie apporte quelque chose d’un point de vue pratique. Je réponds souvent que ma citation leitmotiv est « tout ce qui tue ne pas rend plus fort », car cela correspond bien au cyclisme. Mais, honnêtement, c’est plus ou moins pour me débarrasser de la question.
C’est ce que vous racontez dans Socrate à vélo. Ce jeu quasi permanent entre les médias et les cyclistes. « Face au journalisme à la chaîne, impossible de ne pas tomber dans une forme d’automatisme : telle question déclenche telle réponse, selon un algorithme personnel développé au fil des interviews », écrivez-vous.
C’est triste à dire, mais on est parfois obligé de construire un personnage, de dire ce que les gens ont envie d’entendre.
Vous développez l’idée de l’intelligence du corps. L’avez-vous découvert par le biais du sport, ou par celui de la philosophie à travers les écrits de Nietzsche ?
J’en fais l’expérience en tant que cycliste. Acteur et consommateur de sport au quotidien, je vois même le génie que contiennent certains corps, qui intériorisent le mouvement et le maîtrisent à la perfection. L’œuvre de Nietzsche y répondait parfaitement. Tracer des liens était alors assez facile.
« Le sport est une vanité reconnue comme telle »
Quelle est selon vous la place du sport dans nos sociétés ?
Le sport a une utilité comme exutoire. Nos vies sont de plus en plus rangées. Les gens font de plus en plus un travail intellectuel et sont très souvent au bureau. Nos sociétés sont tellement contrôlées, avec des impératifs de maîtrise et de respect des codes qu’on a besoin dans le même temps de se libérer avec des sports extrêmes, l’ultra trail etc… Malgré le numérique, il faut bien que le corps s’exprime. Le mouvement inverse d’expansion et de développement du sport répond à ce besoin intérieur d’agir, que chacun possède en lui. C’est un retour à une animalité première que l’on a tendance à oublier. Le sport permet de revenir au corps. On n’est pas le même quand on pratique un sport que dans la vie normale. Ce sont les deux faces opposées qui se répondent l’une l’autre.
Le sport peut toutefois prendre une place prédominante, que ce soit pour une Coupe du Monde de football ou un Tour de France.
Oui, avec le processus de starification, et toutes les dérives que l’on constate. Cela peut presque faire peur de voir cela de l’intérieur. Je n’ai pas l’impression d’être une personne différente depuis que je professionnel. Le regard des gens a en revanche changé. C’est assez étrange.
Vous ressentez ce décalage ?
Evidemment. C’est encore plus perceptible après le Tour de France. Quand on a le tampon Tour de France, les gens ont l’impression de tout connaître de nos vies après nous avoir vus à la télé.
Ressentez-vous parfois un caractère vain au sport de haut niveau, en décalage avec les enjeux actuels ?
Non. Je pars du principe que si on va au bout des choses, tout est vain. « Vanité des vanités, tout est vanité ». Le sport est même une vanité reconnue comme telle. On sait que c’est un jeu. On se prend au sérieux, on se prend à encourager son équipe de football. Mais, en toile de fond, on sait que c’est pour de rire. L’intérêt du sport est qu’il permet de déconstruire cette vanité. Cela ne veut pas non plus dire que je ne suis pas sérieux (à l’entraînement et en compétition). Pour être un bon acteur, il faut croire à son personnage.
« La douleur doit être expérimentée »
Que ressentez-vous lorsque vous gagnez une course ?
C’est beaucoup de plaisir ; une décharge d’adrénaline dionysiaque sur un très court instant, alors que la majeure partie de la course, apollinienne, est sous contrôle. Puis très rapidement, chez moi en tout cas, je prends de la distance par rapport à ça.
C’est à dire?
Je me dis qu’en tant que leader de mon équipe, gagner est normal. C’est le devoir accompli. Puis il y a les réponses aux journalistes et je rentre dans une forme de jeu.
Vous dressez un parallèle entre la sémantique de la lutte évoquée chez Nietzche et la douleur ressentie sur le vélo. Comment la décririez-vous ?
Je compare l’entraînement sportif et la souffrance à la notion d’éternel retour chez Nietzsche, qui encourage à ne pas seulement accepter la douleur ou les moments de peine de l’existence, mais à les vouloir et les aimer. Je pense que le sportif est obligé d’y parvenir. Ce n’est pas tenable, sinon.
La douleur, c’est une expérience de l’instant présent, « de vie en direct ». Quand on est à un stade avancée de douleur, on n’analyse pas, on ne réfléchit pas à ce qu’il s’est passé avant, ou à ce qu’il va se passer ensuite. On est pleinement là, ici et maintenant.
C’est difficile de décrire ces sensations?
C’est quelque chose qui n’est pas vraiment descriptible. Oui, des écrivains, des journalistes ou des philosophes peuvent s’en rapprocher avec des mots, mais le format même de l’écriture crée un truchement qui fait qu’il reste toujours une petite distance. C’est de l’ordre de l’intraduisible. On ne parviendra jamais à transmettre vraiment le vécu. C’est quelque chose qui doit être expérimenté.
« Le mental dans les sport est un mythe »
Dans le livre, vous retracez l’historique de la différenciation entre le corps et l’esprit. Vous regrettez que le sportif ne soit seulement défini par sa performance. La tête et les jambes ne font qu’un ?
Oui, il est absurde d’introduire une conjonction entre les deux. Mais je trouve encore plus dommageable que cette performance physique, qui est pour moi première, soit assujettie à une force morale, mentale, à la volonté. “Lui, il en veut ; c’est dans la tête”. Il y a tout un mythe du mental dans le sport aujourd’hui. Si on peut dire que l’esprit craque, c’est parce que le corps a été usé par des heures et des heures de selle. C’est d’abord le corps qui craque. A mon avis, tous les sportifs de haut niveau sont capables d’atteindre le même niveau d’intensité ; d’aller aussi loin dans la douleur. Ce n’est pas ça qui fait la différence. La pression est aussi un marqueur physique, une réaction chimique dans le corps, lié à certaines hormones.
Vous écrivez que « le sport moderne est habité par une forme d’hypocrisie » : les valeurs de l’olympisme et de fair-play véhiculées à l’origine par Pierre de Coubertin et rabâchées ici et là se heurtent à votre réalité de sportif de haut niveau. Essayer de lier ces deux aspects, est-ce vraiment incompatible?
C’est tout à fait compatible, mais l’essence du sport est de battre l’adversaire. Il n’y a pas de mal à ça : le cadre institutionnalisé du sport le permet, et le valorise, même. La sublimation du corps ne se fait pas avec un partenaire, mais avec un adversaire que l’on doit battre.
On ne peut battre pas son adversaire avec bienveillance?
Je ne dis pas qu’il faut vouloir écraser son adversaire ou le traiter comme un inférieur. Mais, sur le moment de la compétition, l’adversaire est un adversaire : ce n’est pas un ami avec lequel on cherche ensemble, comme le souligne l’étymologie de compétition, « cum petere ». C’est aller contre. Si on veut un échange authentique, on fait des arts, du théâtre, de l’aïkido, un art martial que j’ai pratiqué pendant dix ans où il est question de partenaires. Mais, selon moi, on ne trouve pas cela dans le sport.